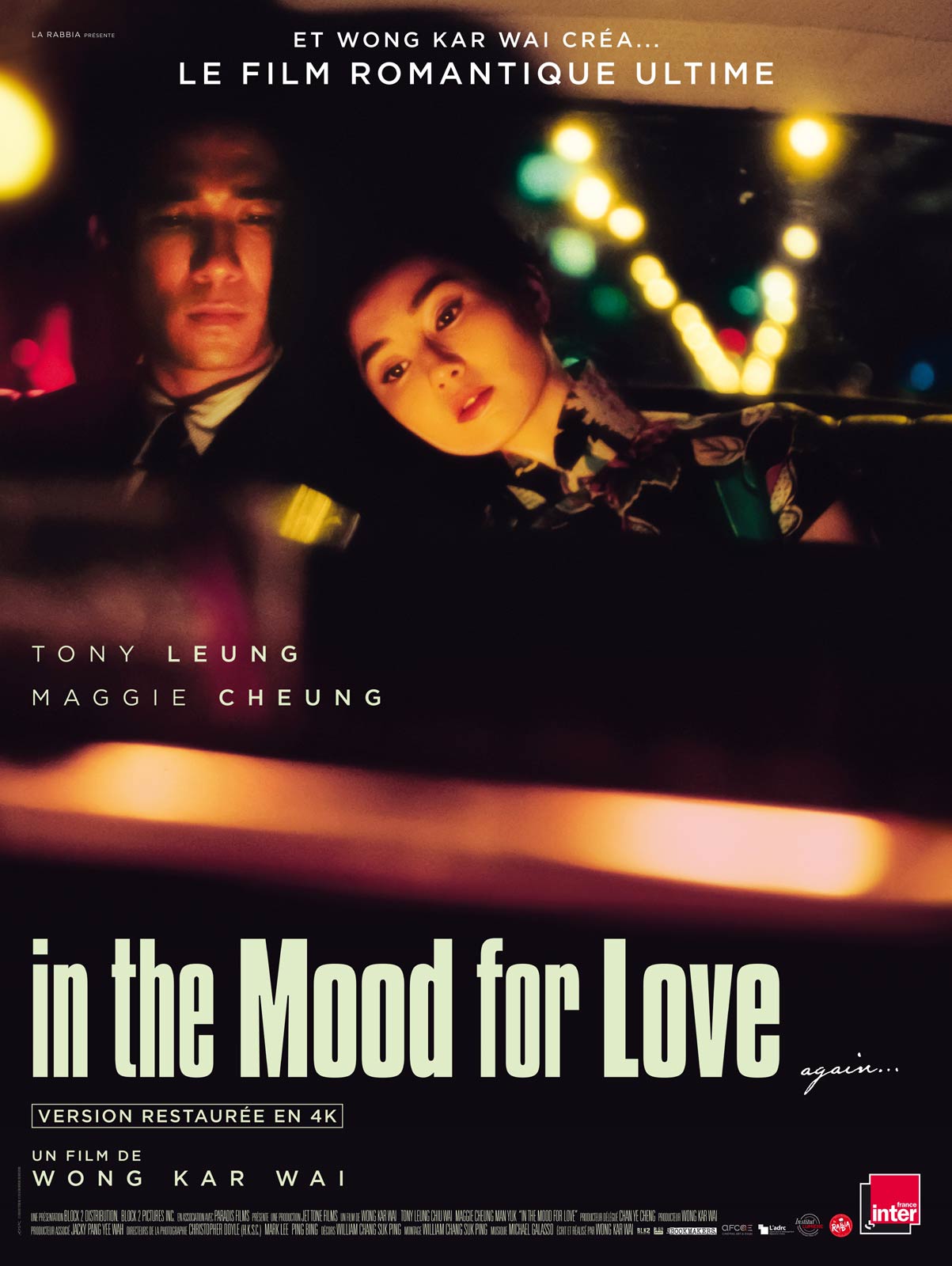Un film de Jeanne Herry (Fr, 1h58) avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti…
Un film de Jeanne Herry (Fr, 1h58) avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti…
Un groupe de victimes de crimes et de délits participe sous l’égide de médiateurs à une série de rencontres avec des auteurs d’infractions. Ce dispositif, la “justice restaurative“, vise par la parole à permettre aux premières d’évacuer leurs traumatismes ; aux seconds de mesurer les conséquences de leurs actes et bien sûr, de prévenir la récidive. Portrait collectif (mais aussi individuel) du processus…
Avec Pupille, Jeanne Herry avait déjà donné de la chair et de l’âme à une problématique sociétale (l’adoption des enfants nés sous X et confiés par l’aide sociale à l’enfance à des familles d’accueil) sans être piégée par la dimension “illustrative” du film-dossier ; elle approfondit ici son exploration de cette zone tampon entre la justice et le social, où le besoin d’une médiation humaine — certes très encadrée mais sans uniforme ni toque — permet aux individus en besoin de reconstruction d’opérer leur restauration intime, réconciliation ou réadaptation avec le monde.
Son cinéma, une fois encore, va au-delà du mode d’emploi d’un métier ou d’un savoir-faire : davantage qu’un chapelet de “cas“, les personnages sont habités et se trouvent tous à égalité, qu’il s’agissent des victimes, auteurs de faits ou des encadrant dont on devine la vie “à-côté” au travers des small talks entre les groupes de parole. Sans faire de la justice restaurative une panacée, Je verrai toujours vos visages met l’accent sur un manque réel dans le parcours pénitentiaire et insiste sur toutes les prises de conscience naissant de (et par) la parole. À méditer.
Pour son troisième long-métrage, Jeanne Herry s’intéresse à une étonnante alchimie : la rencontre entre coupables et victimes dans le cadre de la justice restaurative. Un processus qui donne matière à réflexion cinématographique et révèle sa méthode de réalisation. Conversation.
Comme avez-vous découvert l’existence de la justice restaurative, mise en place par des associations de victimes et l’administration pénitentiaire ?
Jeanne Herry : J’étais en train de me documenter globalement dans le monde judiciaire qui m’a toujours beaucoup intéressée depuis je suis enfant, peut-être pour essayer de faire un film de procès, et par le biais d’un podcast j’ai découvert l’existence de la justice restaurative. J’ai trouvé ça passionnant : ça a allumé un feu, vraiment. J’ai eu envie de comprendre ce qu’était ce dispositif ; qui faisait ça des petites aux grandes lignes, la philosophie générale, le détail des protocoles…
Pendant trois ou quatre mois, je suis allée me documenter auprès des gens qui mettent en place cette justice, mais aussi du côté de ceux qui y ont participé. Ces rencontres se terminent, qu’on le veuille ou non, par des gens qui se prennent dans les bras. Après, est-ce qu’ils vont être amis toute leur vie, est-ce que ça va conditionner le reste de leur vie, est-ce que plus jamais ils ne vont récidiver ? On n’en sait rien. C’est juste un outil concret, pensé, précis, qui a de très très bons résultats, qui existe et qui est à notre portée.
Chacun se répare et répare les autres et se répare en se réparant… Quand je me suis documentée, tout le monde semblait dire que c’était ultra puissant, qu’à la fin ça tissait des liens, j’ai essayé de comprendre pourquoi ça marchait au bout de cinq rencontres — ça me paraissait très peu. Quand j’ai eu terminé, que j’ai tout bien compris toutes les étapes (la place des membres de la communauté, les entretiens de préparation avant, les rencontres entre trois victimes, puis les trois auteurs, puis tout le monde…), j’ai compris que c’était impossible que ça ne marche pas, que ça ne tisse ne serait-ce qu’un tout petit peu de lien. Au bout de 15h d’échanges où les gens se mettent à nu les uns en face des autres, il y a une reconnaissance de l’humanité et de la souffrance des autres, on se dit que l’autre fait penser à son frère, etc. L’autre nous ressemble même si on est irréconciliable et qu’on n’ira pas boire un verre avec lui, on le comprend un tout petit peu mieux.
C’était une promesse de cinéma, ce terrain de jeu : j’ai vu du cinéma partout et l’opportunité d’écrire des rôles riches et intéressants pour les acteurs — ce qui est ma motivation première.
Comme pour Pupille, vous n’avez voulu montrer que ce qui fonctionne…
C’est vrai, c’était encore plus criant pour Pupille. J’aurais pu tout à fait décider de montrer un service qui dysfonctionne, qui rate à cause de la souffrance ou de la difficulté à bien travailler — ce qui est aussi une partie du réel. Il se trouve qu’il y a des services qui fonctionnent bien et qui arrivent à mener les missions qui leur sont confiées. Mais je suis quelqu’un d’assez positif et optimiste de nature ; je suis plus douée pour ça. Si je voulais montrer ce qui ne va pas bien, je pense que je le ferais très mal. Il y a une petite prime dans le cinéma français à la noirceur et aux mauvais sentiments ; il se trouve que j’adore explorer les bons sentiments. Je sais plutôt montrer ce qui est beau, ce qui marche bien et dire qu’on devrait le protéger ou le promouvoir. Ça me ressemble plus.
Vous avez vu du cinéma et des rôles partout lors de vos recherches. À l’écriture, est-ce que vous pensiez “rôles” ou déjà “comédiens” ?
Les deux. Mais avant de penser rôle, je pense situation. Mettre des braqueurs en face de gens qui ont été braqués, déjà c’est très fort d’un point de vue situationnel. C’est formidable à écrire et à jouer pour des acteurs ; après il faut choisir la typologie de crimes, quel endroit des agressions explorer, etc. Il y a un souci d’équilibre : autour de ce cercle, je veux qu’il y ait toutes les corpulences, toutes les origines ethniques, tout type d’âge… Ça donne des personnages qui s’affinent petit à petit.
Parfois, ce sont des acteurs qui me donnent envie d’écrire certains personnages ; d’autres arrivent en fin de parcours. Gilles Lellouche, Élodie Bouchez et Leila Bekhti, j’ai vraiment écrit pour eux ; quand j’ai débuté ma documentation, je savais déjà que je proposerais à Gilles le rôle d’une victime, pareil pour Leila. Et pareil pour Élodie : je savais que je lui proposerais un rôle de médiatrice. Évidemment ça conditionne ma façon d’écrire ces rôles, puisque j’ai déjà leur visage, leur voix… C’est super quand, enfin, au bout du parcours, le dernier acteur vient composer le casting — en l’occurrence, c’était Fred Testot — : il a autant de légitimité et d’évidence pour le rôle que Gilles qui était là au départ.
Mais la distribution est évidemment un équilibre — de visages, de tout… Je travaille beaucoup en accord de voix. Par exemple, le binôme que forme Élodie avec Adèle Exarchopoulos : c’est très intéressant pour moi d’avoir Élodie — qui est une actrice si émotionnelle, qui sait jouer la vulnérabilité, la fragilité avec beaucoup d’aisance — pour incarner la solidité avec une voix plutôt dans les aigus, et pour incarner la victime qui va dire ses fragilités ; d’avoir Adèle qui a une voix très grave (voire vraiment très très grave le matin). C’était important d’accorder ces deux voix parce que le film est aussi une partition. Il y a quelque chose qui se tisse à deux avec deux voix qui s’accordent.
Comment travaillez-vous le texte avec vos comédiens ?
 Je donne un texte qui est très très très très précis et je leur demande de le respecter jusque dans la ponctuation. Mais avant, quand même, on se fait des rendez-vous en tête à tête, On lit le texte et on l’amende. Pour le personnage de Sabine, il y avait quelque chose d’un petit peu particulier : normalement, je peux mettre pour le lecteur « elle se brise » ou « elle fond en larmes » mais généralement je dis aux acteurs de se débarrasser tout de suite de ces intentions : s’ils doivent pleurer dans la séquence, ils pleurent. Il y avait deux-trois rendez-vous de larmes qui étaient importants pour moi dans le film, notamment celui de Sabine. Là, il me fallait son craquage. J’en avais besoin. C’est beaucoup plus de pression pour les acteurs, c’est vachement dur. Je dis toujours que je m’en fous que ce soient des vrais larmes : il y a des trucs qui aident mais Maman m’a dit : « les fausses-larmes, moi ça marche pas, je suis allergique »
Je donne un texte qui est très très très très précis et je leur demande de le respecter jusque dans la ponctuation. Mais avant, quand même, on se fait des rendez-vous en tête à tête, On lit le texte et on l’amende. Pour le personnage de Sabine, il y avait quelque chose d’un petit peu particulier : normalement, je peux mettre pour le lecteur « elle se brise » ou « elle fond en larmes » mais généralement je dis aux acteurs de se débarrasser tout de suite de ces intentions : s’ils doivent pleurer dans la séquence, ils pleurent. Il y avait deux-trois rendez-vous de larmes qui étaient importants pour moi dans le film, notamment celui de Sabine. Là, il me fallait son craquage. J’en avais besoin. C’est beaucoup plus de pression pour les acteurs, c’est vachement dur. Je dis toujours que je m’en fous que ce soient des vrais larmes : il y a des trucs qui aident mais Maman m’a dit : « les fausses-larmes, moi ça marche pas, je suis allergique »
C’était le grand rendez-vous du personnage de Miou, ce craquage de Sabine et pour une fois, il y avait une obligation de résultat. C’est pour ça qu’on s’était vues en amont, qu’on avait travaillé le texte parce que ce sont des appuis : il y a des mots, des endroits qui vont générer de l’émotion quand on les dit. Il faut juste qu’ils soit placés au bon endroit. Elle a été au rendez-vous du personnage.
C’est un film sur la parole mais aussi sur la voix. Comment dirigez-vous la hauteur et le placement de la voix ?
Chacun arrive avec sa voix propre que je connais un petit peu, donc je sais que je vais pouvoir m’accorder. Dali Benssalah a une voix extrêmement profonde et grave ; je connaissais très bien celle de Birane Ba parce qu’on avait travaillé au théâtre ensemble… Après, on ne fait pas grand chose : ils ont leur voix, c’est leur instrument et de temps en temps, je dis à maman [NdlR : Miou-Miou] « ne projette pas trop » ; parfois je dis « timbre un peu plus ; mets un peu plus d’énergie ». Ce sont des micro détails…
Il y a deux fils narratifs qui se croisent. Celui du cercle — qui, davantage qu’un dispositif théâtral, évoque quelque chose d’orchestral — et celui de la soliste pour les séquences avec Adèle Exarchopoulos. La direction d’acteurs était différente entre la partie orchestre et la partie soliste ?
Déjà, je suis d’accord avec vous sur le côté orchestral plus que théâtral : c’est comme ça que je le vis vraiment ; c’est pour ça que je parle de partition et de voix. Pour moi, je fais du cinéma avec l’oreille et l’image sonne juste ou pas. Mais c’est le son qui l’a fait sonner juste. Ce sont les mots qui construisent tout, y compris les images. Je construis des images avec des mots ; c’est pour ça que je ne suis pas une femme d’images, même si je suis réalisatrice.
Il n’y a pas de direction d’acteurs différente ; ce sont juste deux situations différentes. Dans le cercle, ils étaient dix, avec neuf qui écoutaient. Il y avait énormément de soutien parce que chacun était logé à la même enseigne, chacun avait beaucoup de choses à dire, c’était coûteux d’un point de vue du jeu. Après le premier monologue de Leila, elle a parlé pendant neuf minutes, tout le monde a applaudi et ça s’est renouvelé tout le long du tournage de manière très spontanée. Dans le petit bureau avec Adèle, on était moins dans la géométrie très pure du cercle : c’était un trait avec deux personnes reliées par un fil de part et d’autre d’un bureau. Ce n’est pas dirigé différemment mais, ne serait-ce que pour elles deux, c’est différent d’être écoutées par neuf personnes en cercle ou d’être dans ce bureau plus petit, plus préservées, dans le regard d’une seule personne. Ça change quelque chose dans le jeu de manière intrinsèque.
(Article du Petit Bulletin Lyon – Vincent Raymond – 28 mars 2023)